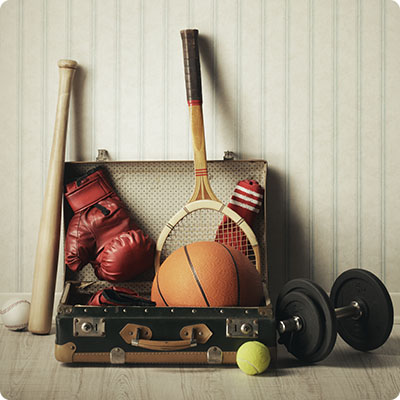Controverses et officialisation
Avant que l’année 1945 ne voit normalisée et officialisée la langue macédonienne, les siècles précédents assistèrent à des débats qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, en quelle langue écrivaient les poètes nés dans des villes amenées à appartenir à la Macédoine du Nord contemporaine ? D’aucuns évoquent le bulgare, d’autres, déjà, revendiquent le macédonien. Ces divergences, qui tiennent tout autant du domaine de la linguistique que de la question du nationalisme, ne sauront trouver résolution ici. Tout juste pourrons-nous évoquer trois auteurs dont l’œuvre, justement, nourrit cette polémique : le prêtre Joachim Kartchovski (v. 1750-1820), dont les textes rédigés en langage populaire portèrent sa foi, Kiril Peïtchinovitch (v. 1770-1845), qui usait du dialecte de sa région natale, le polog, pour ses livres également religieux, et Partenija Zografski (1818-1876), qui se fit folkloriste et philologue. La tradition orale irrigua ensuite le travail de Dimitar Miladinov (1810-1862) et de son frère Konstantin (1830-1862) : ils collectèrent plus de six cents chansons populaires publiées en recueil en 1861 à Zagreb. S’ils se revendiquaient Bulgares – et que leur démarche leur coûta des ennuis avec le gouvernement ottoman qui s’inquiéta de leur parti pris panslave –, il n’en demeure pas moins qu’ils étaient originaires de Struga, désormais en Macédoine du Nord. De prime abord, le profil de Krste Petkov Misirkov (1874-1926) ne semble pas soulever ce genre de questionnements identitaires puisqu’il œuvra dès le début du XXe siècle à établir une langue macédonienne standardisée. Pour autant, ses revirements politiques motivent encore les contradicteurs, même si, néanmoins, certains l’ont proclamé sans désemparer père du macédonien littéraire moderne. Le consensus paraît enfin trouvé avec Kotcho Ratsin, né Kosta Apostoi Solev en 1908, qui hérita pour sa part du titre de père de la littérature macédonienne. Son œuvre est en effet clairement délimitée : il écrivit tout d’abord en serbo-croate et en bulgare, puis ajouta à ce panel en 1936 le macédonien. C’est bien dans cette dernière langue que fut composé trois ans plus tard Aubes blanches qui lui valut une grande renommée dans toute la Yougoslavie, et surtout en Macédoine du Pirin, une région qui est certes en Bulgarie mais où se parle la même langue qu’en Macédoine du Nord. Les dissensions n’étaient pourtant pas terminées à en croire Venko Markovski qui publia en 1938 Narodni Bigori mais utilisa ensuite le bulgare : jusqu’à la veille de sa mort, en 1988, il tergiversa sur ses racines. Plus tragique encore fut le destin de Kolé Nedelkovski, membre du Cercle littéraire macédonien fondé à Sofia en 1938, qui dut fuir à cause de ses poèmes révolutionnaires écrits dans le dialecte de Skopje et perdit la vie, à 28 ans, lors de cet exil précipité.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l’heure de la proclamation de la république socialiste de Macédoine, la reconnaissance officielle du macédonien en tant que langue littéraire sonna donc comme la possibilité d’apaiser les différends et coïncida avec la naissance d’une littérature macédonienne qui rêvait de se définir comme telle, à en croire la création – dès 1947 ! – de la première Association des écrivains du pays. Évidemment, cela ne se fit pas sans heurts, la « neutralité linguistique » de Blaze Koneski, qui a standardisé le macédonien, fut elle-même mise en doute. Il reste pourtant considéré comme le chef de file de la première génération d’auteurs et a été abondamment récompensé pour ses nombreux recueils poétiques. La poésie est en effet le genre de prédilection de ces pionniers que furent Vlado Maleski (1919-1984), notamment connu pour avoir écrit les paroles de l’hymne national Denes nad Makedonija, Aco Sopov, qui se découvre en français chez Actes Sud (Anthologie personnelle : 1950-1980), ou Gane Todorovski, illustre académicien au sein de la MANU (Académie macédonienne des sciences et des arts) et président des non moins prestigieuses Soirées de poésie de Struga, festival à la réputation internationale. Leur contemporain, Slavko Janesvski né en 1920 à Skopje, s’illustra dans tous les arts littéraires mais est surtout renommé pour avoir écrit le premier roman en macédonien standard, Le Village derrière les sept frênes, paru en 1952, prémices d’une œuvre foisonnante.
Modernes et contemporains
Celui qui incarne la seconde génération d’écrivains macédoniens est sans conteste Mateja Matevski bien qu’il soit né à Istanbul en 1929 dans une famille albanaise. Étudiant puis professeur à Skopje, il sera par ailleurs journaliste et rédacteur en chef notamment de la revue Mlada literatura. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la littérature prend effectivement un virage, elle se « professionnalise » en quelque sorte, devient l’objet de jeunes diplômés qui lui apportent une nouvelle complexité, parfois tournée vers le surréalisme. L’œuvre conséquente de Matevski – une trentaine de livres, dont seul Naissance de la tragédie a eu les honneurs d’une traduction française – le place au faîte de cette nouvelle envolée, mais nous pourrions à ses côtés placer Vlada Urosević (Ma Ccusine Émilie chez L’Âge d’homme, Une autre ville au Temps des Cerises éditions), Petre M. Andreevski, renommé pour son roman historique Pirej et son recueil poétique Denicija, Zivko Čingo dont on peut lire la réédition de La Grande Eau au Nouvel Attila et les nouvelles réunies sous le titre Paskvelija chez Non Lieu… Néanmoins, celui qui a eu le plus d’écho dans notre langue reste Luan Starova (1941-2022), qui fut ambassadeur (notamment à Paris) et avait la particularité d’écrire aussi bien en macédonien qu’en albanais. Fayard propose toujours ses romans en impression à la demande (Le Temps des chèvres, Les Livres de mon père, Le Musée de l’athéisme), sa poésie est sous bonne garde aux Écrits des Forges (Poèmes de Carthage) et aux éditions des Syrtes (Le Chemin des anguilles).
Si l’art poétique – que théorisa Katica Kulavkova dans ses thèses universitaires – garde la primauté, le théâtre s’impose grâce à de nombreux dramaturges tels que Kole Časule (1921-2009), Tome Arsovski (1928-2007) ou, plus proches de nous, Goran Stefanovski (Éloge du contraire, Le Démon de Debarmaalo…) et Jordan Plevnes (Erigon, La Peau des autres…), tous deux nés dans les années 1950, puis Venko Andonovski (Cunégonde en Carlaland), leur cadet. Grâce au formidable travail de passeur de certains éditeurs tels que L’Espace d’un instant, la scène théâtrale devient ainsi le lieu privilégié où la littérature macédonienne peut s’offrir au monde. Une nouvelle génération, née à partir des années 1970, commence pourtant à se faire connaître au-delà des frontières, à l’instar de Lidija Dimkovska (Comment c’est, chez Al Manar), Nikola Madzirov, Goce Smilevski (La Liste de Freud, 10-18), Slavo Koviloski, Rumena Buzarovska (Mon cher mari, Gallimard), Petar Andonovski (La Peur des barbares, éditions Glassroots) et Nenad Joldeski, tous deux lauréats du prix européen de Littérature, ou enfin le benjamin, Stefan Markovski.