Le Musée des Arts Islamiques (MIA), qui avait pourtant une scénographie spectaculaire et bien menée de Wilmotte depuis son ouverture en 2008, a été fermé pendant deux ans et a fait peau neuve en septembre 2022, juste avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot. La collection s'est agrandie et il a été opéré une refonte profonde de ses galeries permanentes. Près de 900 objets relatifs à l'art islamique sur 1400 ans sont désormais exposés (contre 600 auparavant), dont 60 % de nouvelles pièces, certaines monumentales. Des expositions temporaires sont également organisées.
L'édifice. L'édifice du Musée des Arts Islamiques a été édifié en 2008 par le génial architecte américain d'origine chinoise Ieoh Ming Peï (à l'origine de la pyramide du Louvre à Paris). Le spectacle de sa beauté s'impose à tous. Une forme complexe constituée d'un puits lumineux circulaire, puis octogonal, puis quadrangulaire. Une forteresse délicate de grès français, percée de rares ouvertures visibles, mais pourvue d'une monumentale baie vitrée côté mer. C'est dans cet espace que se trouve le MIA café, dont l'intérieur en verre et en blanc avec vue sur la skyline de Doha, a été imaginé par le designer français Philippe Starck.
Tout autour du musée, le parc du MIA vaut une visite, notamment une sculpture de Richard Serra (un "7", hautement symbolique dans la culture islamique) qui se trouve face à la mer en bout de jetée en croissant de lune, et qui a été pensée avec le projet originel du MIA. On aime aussi se reposer sur les pelouses vertes impeccables parsemées de jeux pour enfants et de petits cafés. Une jetée supplémentaire a été ajoutée au MIA, appelée "le port" de Doha où viennent s'amarrer les bateaux de croisière, elle compte de nouveaux hôtels et restaurants.
La collection. Elle expose près de 900 objets d'art islamique : céramique, verrerie, manuscrits, travail du métal et textiles. La collection du MIA comprend désormais plus de 800 manuscrits, beaucoup d'exemplaires historiques, dont certains datent du VIIe siècle, mais aussi des manuscrits ottomans du XIXe siècle. On peut y admirer quelques pages du célèbre Coran bleu abbasside (datant du califat irakien au Moyen Âge), est l'un des manuscrits les plus beaux au monde, qui a d'autres pages exposées au MoMa de New-York. Le musée abrite aussi deux des cinq pages seulement connues du Coran Baysunghur de Timouride, le plus grand Coran du monde.
Parmi les "masterpieces", mentionnons un superbe cheval de bronze d'Espagne du Xe siècle, une armure complète de cavalier ottoman et de son cheval du XVe siècle. Mais aussi de rarissimes tapis perses, des tapis indiens (dont un magnifique fabriqué au Cachemire au XVIIe siècle), une impressionnante collection d'astrolabes en cuivre... Des vases et poteries de toute l'Arabie sont exposés dans les vitrines, dont le vase Cavour fabriqué à Damas en Syrie, du XIVe siècle. De nombreux objets témoins du rayonnement arabe au Moyen Âge en Europe, de l'Espagne omeyyade (qui a vécu sept siècles de colonisation arabe) à la Sicile arabo-normande (lorsque les arts byzantins, arabes et normands ont fusionné), de l'Égypte ayyoubide à l'Inde du Shah Jahan, en passant par la Perse de Tamerlan (actuel Iran). Beaucoup d'objets proviennent également d'Irak, pendant le califat des Abbassides, et de son rayonnement dans la région : Syrie, Palestine... On y croise aussi bien des scènes de chasse de manuscrits persans que des léopards courant sur un tapis indien. On y admire de très nombreux bijoux indiens étincelants de pierres précieuses. Un faucon venant de Jaipur (du XXe siècle) richement serti de rubis, diamants, émeraudes et saphirs est l'une des pièces maîtresses de cette collection.
Sitara de la Ka‘ba, tissus de porte de la Ka'ba de la Mecque) 1839-1861.
Réalisé pour le sultan Abdülmecid au XIXe siècle en Égypte, pendant la période ottomane, ce tissu recouvrait autrefois le monument le plus sacré du monde islamique : la Ka'ba à La Mecque. Un kiswa entier se compose de plusieurs sections de tissu brodé (sitara) cousues ensemble pour couvrir la Ka'ba comme un rideau. Il a probablement été remplacé lors d'une cérémonie annuelle de l'Aïd al-Adha. À partir de la période ayyoubide (XIIe siècle), les kiswas étaient fabriqués au Caire chaque année et envoyés en cadeau dans un palaquin (mahmal) avec les processions des pèlerins à La Mecque.
Décret impérial, ou firman, de Soliman le Magnifique. Turquie (1559).
Par cet édit rédigé en turc ottoman, Soliman le Magnifique a cédé à sa petite-fille un palais à Istanbul. Le texte commence par une formule invocatoire et s'achève avec la signature des témoins. La tughra, la signature du souverain, occupe une place centrale : elle est d'une dimension impressionnante et abondamment ornementée. La tughra de Soliman le Magnifique – qui régna de 1520 à 1566 – est l'une des plus belles. Ici, les lettres bleu outremer sont soulignées d'or ; les verticales, les courbes, les boucles et les entrelacs, exécutés d'une main assurée, donnent à la tughra un rythme musical. Les différents compartiments de cette composition calligraphique sont tapissés de pousses délicates, de branches feuillues spiralées et de petites fleurs. L'impressionnante tughra, l'élégance du divani (l'écriture de la chancellerie ottomane), l'or utilisé, la taille substantielle du rouleau et la place importante occupée par les quelques lignes de texte donnent à ce document beaucoup de majesté et transforment un papier officiel en une œuvre d'art.
Amulette, Inde, XVIIe siècle
Le jade blanc a été poli : il est lisse au toucher. Il porte une inscription élégamment calligraphiée en nasta'liq. Gravée dans le jade blanc, elle crée un subtil effet de blanc sur blanc, à peine perceptible mais elle est présente sur trois faces de l'amulette, sur le devant, au dos et dessous. Elle se compose de versets coraniques ; elle indique en outre le nom et les titres de Shah Jahan ainsi que l'année 1041 du calendrier musulman (1631-1632 en calendrier chrétien). Ce haldidi, un type de pendentif censé aider à calmer les « battements de cœur » de celui qui le porte, fut fabriqué quelques mois après la mort de Mumtaz Mahal, l'épouse de l'empereur. Celui-ci immortalisa son amour pour elle en lui faisant construire un magnifique mausolée, le Taj Mahal.
Coupe, Irak (probablement Bassora), IXe siècle.
Cette coupe est d'un extraordinaire minimalisme. Son seul décor : une ligne de calligraphie qui s'étire sur la moitié de sa surface. C'est d'un effet saisissant. Cette écriture très aérienne plonge la coupe dans un silence profond, en partie dû à la place particulière accordée au « vide ». « ma ‘oumila salouha » (« Ce qui a été fait en valait la peine »), dit la phrase en bleu cobalt, écrite en caractères coufiques. Le trait enlevé vibre en bout de lettres, et se transforme en un motif folié. Au début du IXe siècle, les potiers musulmans étaient fascinés par la porcelaine chinoise. Les potiers de Bassora, un centre de céramique renommé pour la qualité de ses productions, eurent alors l'ingénieuse idée de recouvrir leurs modestes céramiques d'une glaçure opaque afin de lui donner un aspect plus raffiné. Mais la véritable innovation fut l'introduction de décors bleu cobalt sur fond blanc. Ils furent ainsi à l'origine de la céramique « bleue et blanche » qui fleurit entre les mains des potiers chinois quelques siècles plus tard.
Biche, bouche de fontaine, Espagne, milieu du Xe siècle.
Cette belle biche, à l'attitude paisible et au regard songeur, est probablement originaire d'un palais andalou du Xe siècle, édifié pendant la période omeyyade. On a trouvé un cerf assez similaire dans les ruines de Madinat al-Zahra (près de Cordoue), et il est possible que tous deux aient orné la même fontaine. Dans les palais islamiques, les fontaines sont des éléments architecturaux très importants. Une fontaine comportant une biche et un cerf devait avoir une haute fonction symbolique. La qualité sculpturale de cette biche, notamment de sa tête, est étonnante. Pas de naturalisme, mais une forme stylisée qui rend compte des traits essentiels de l'animal. Sa dimension abstraite se trouve renforcée par un décor d'arabesques : les lignes ondulent, formant un motif régulier à base de demi-palmettes encerclées.
Le saviez-vous ? Cet avis a été rédigé par nos auteurs professionnels.
Les points forts de cet établissement :
Avis des membres sur MUSEUM OF ISLAMIC ART
Les notes et les avis ci-dessous reflètent les opinions subjectives des membres et non l'avis du Petit Futé.




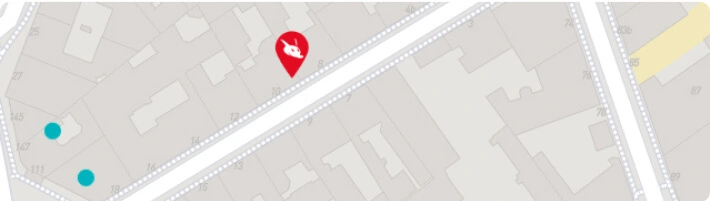




À l'arrivée au MIA, on est immédiatement captivé par la majestueuse façade qui se dresse fièrement au-dessus de l'eau et par le parc entretenu qui entoure le bâtiment. La vue sur la baie de Doha depuis le musée est un cadre spectaculaire qui rend la visite encore plus mémorable.
À l'intérieur, le musée possède une impressionnante collection de plus de 14 000 objets allant des débuts de la période islamique au XIXe siècle. Chaque collection est soigneusement conservée et l'on peut y trouver de magnifiques manuscrits, des céramiques, des textiles, des objets en métal et bien d'autres choses encore. Il est évident qu'un grand soin a été apporté à la mise en valeur des compétences artisanales et du contexte culturel d'où proviennent ces objets.
L'une des expositions les plus époustouflantes est la magnifique collection de calligraphie islamique, qui associe admirablement l'art et la langue. La beauté détaillée des œuvres manuscrites est un régal pour les yeux et rappelle le profond respect et l'importance des mots et de l'écriture dans la culture islamique.
L'intérieur du musée est tout aussi impressionnant que l'extérieur. Les galeries spacieuses, hautes de plafond, et la lumière naturelle qui pénètre par les grandes fenêtres créent une atmosphère accueillante. Le design minimaliste permet aux œuvres d'art de briller et il y a plusieurs endroits calmes pour réfléchir à ce que vous avez vu.
Café et boutique :
Après une visite approfondie du musée, une visite au café s'impose, où vous pourrez prendre un rafraîchissement avec vue sur la baie. Le menu propose de délicieux plats du Moyen-Orient et une sélection de friandises. La boutique du musée vaut également le détour, car elle propose une sélection de cadeaux uniques et de livres liés à l'art et à la culture islamiques.
Le musée d'art islamique de Doha est une destination incontournable pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans la riche histoire et la culture qui caractérisent le monde islamique. C'est une expérience qui allie l'esthétique, l'apprentissage et l'inspiration. Que vous soyez amateur d'art, conteur ou simplement curieux, le MIA vous laissera sans aucun doute une impression durable. J'ai hâte de visiter à nouveau le musée et d'explorer davantage les trésors cachés qu'il a à offrir.
L’arrivée à partir de la Corniche vers cet imposant amas de blocs superposés se fait par un double allée montante de palmiers avec au centre un canal d’eau de type andalou. On atteint ainsi une vaste place pour entrer dans le musée. Bien qu’il y ait beaucoup de visiteurs, pas d’attente au comptoir des tickets. On pénètre alors dans un immense atrium central, coiffé par un large cercle doré, avec deux escaliers en spirale montant vers le premier étage. Ce vide circulaire central aux larges baies donnant sur le port et les tours de Doha permet de voir les 4 étages du musée que l’on peut visiter soit en montant directement au 4ème et en redescendant les étages un à un ou en montant progressivement vers le sommet.
Le choix du musée est de présenter peu de pièces dans une ambiance assez sombre, en recréant du mieux possible leur contexte par des fresques, des images projetées ou des mises en perspective. C’est parfaitement exécuté et on se transporte ainsi de Damas au Caire, de Cordoue à Izmir, de Delhi à Bagdad dans tous les hauts lieux de l’Islam au travers des livres, des bijoux, des peintures ou des habits.
Déjà conquis par les beautés de ce musée unique et revenus au rez de chaussée, il faut pousser les portes latérales pour découvrir une autre merveille, constituée par une vaste place entourée de jets d’eau donnant sur le port des boutres en premier plan et les tours de Doha au fond de la baie. Quel panorama merveilleux sur cette ville unique !