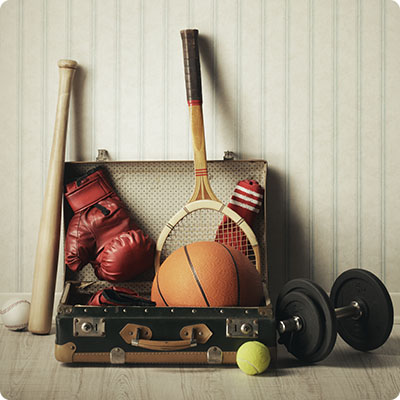L’histoire géologique du Limousin
Les limites administratives de l’ex-région du Limousin ont suivi à grands traits les limites géologiques. La région appartient pour sa plus grande part au Massif central, défini comme un ensemble de granites et de roches métamorphiques datant du Paléozoïque (il y a 539 à 252 millions d'années).
Au début du Paléozoïque, ce qui va devenir le Limousin est entièrement recouvert par la mer et se situe dans l’hémisphère sud. De -450 à -300 Ma, émerge une immense chaîne de montagne (la chaîne hercynienne) qui s’étend sur des milliers de kilomètres à travers l’Europe. À partir de la fin du Paléozoïque (-300 à -250 Ma), la chaîne hercynienne s’érode progressivement. Le socle actuel du Limousin correspond à des vestiges de cette chaîne. Il en résulte, au début du Mésozoïque (-250 à -200 Ma), une vaste plaine parfois immergée, parfois émergée abritant de vastes forêts tropicales. Le continent européen passe progressivement dans l’hémisphère nord.
L’érosion de la chaîne hercynienne produit des sédiments détritiques charriés par les cours d’eau, qui vont former les grès du bassin de Brive en bordure sud du socle cristallin. Entre -250 et -100 Ma, des sédiments marins (calcaires et marnes) se déposent dans une mer peu profonde pour former le Bassin aquitain. À partir de 150 Ma, l’Europe est presque à sa place actuelle.
Des évènements cataclysmiques viennent enrichir la géodiversité du Limousin comme la chute d’une météorite à Rochechouart (-207 Ma) ou l’éruption du volcan cantalien dont les coulées basaltiques atteignent l’est de la Corrèze (-10 à -6 Ma). Le socle cristallin subit encore de nombreux bouleversements liés à la formation des Pyrénées et des Alpes qui structurent le paysage actuel du Limousin.
Sur tout le territoire régional s’observent failles et vallées profondes aux pentes vertigineuses. Elles sont apparues il y a 65 millions d’années et ont été modelées notamment lors de la fonte des glaciers qui recouvraient l’Auvergne voisine. Aujourd'hui, les altitudes atteignent par endroits 800 ou 900 mètres et sur tout le territoire, de nombreuses vallées profondes, aux pentes vertigineuses mais très jeunes à l’échelle géologique, interrompent un haut plateau tandis qu’au sud, le bassin de Brive nous mène via le Causse corrézien aux limites du Quercy et du Périgord.
Les principales roches du Limousin
Remises en surface par l’érosion, les roches métamorphiques et plutoniques couvrent aujourd’hui près de 94 % de la surface du Limousin. Les roches métamorphiques sont issues d'importantes transformations subies par des roches variées dans les profondeurs de la Terre où règnent des températures et des pressions élevées. Elles sont représentées par des gneiss, micaschistes, schistes, serpentinites, amphibolites… Les roches plutoniques, quant à elles, sont des roches provenant de différents magmas refroidis lentement en profondeur : granites, granodiorites, diorites, gabbros…
Le granite est omniprésent dans le Limousin, vous vous en rendrez compte au fil de vos balades. Beige, rose, gris ou bleu, le granite utilisé comme moellon ou en pierre de taille est dans le Millevaches le matériau de construction traditionnel. Les ruines des thermes romains des Cars, près des Millevaches, sont là pour témoigner de cet usage ancestral qui a fait la réputation non seulement des matériaux utilisés, mais aussi de ceux qui savaient si bien l’employer : les maçons de la Creuse. Jusque dans les années 40, les monuments, les bâtisses officielles et les demeures cossues étaient pratiquement toujours bâtis ou ornementés avec des granites taillés d’origine locale.
Il faut noter qu’une grande partie du granite employé pour la construction ne provenait pas des carrières mais de l’exploitation des grosses « boules » ayant résisté à l’érosion, que l’on appelle « blocs solitaires » et qui parsèment çà et là le paysage. Certains sites naturels méritent particulièrement le détour : le chaos granitique des Pierres Jaumâtres, à Toulx-Sainte-Croix, celui de la Rigole du Diable, près de Royère-de-Vassivière, celui de la Chapelle du Rat, à Peyrelevade, ou encore les Rochers de Puychaud, dans les Monts de Blond, qui marquent la limite symbolique entre langue d'Oc et langue d'Oïl.
L'extraction de minerais
Jusqu’à un passé récent le Massif central en général et le Limousin en particulier ont été le lieu de l’extraction de nombreux minerais de substances variées. Citons parmi d’autres, autrefois et en maints endroits, le plomb et le zinc parfois associés à de l’argent ou de l’antimoine, l’étain à Vaulry, le tungstène près de Saint-Léonard-de-Noblat mais surtout l’uranium autour des monts d’Ambazac mais aussi en Creuse et en Corrèze.
L’or a aussi été recherché et exploité, principalement dans le sud de la Haute-Vienne (Saint-Yrieix-la-Perche), le nord de la Dordogne (Jumilhac-le-Grand) et dans l’est de la Creuse de façon discontinue depuis l’époque gauloise jusqu’au début du XXIème siècle. Au total, 37 tonnes de ce précieux métal ont été extraites.
Du charbon s’est déposé lors des premières étapes de l’érosion de la chaîne hercynienne dans des lacs qui occupaient des petits bassins délimités par des fractures du socle (Bourganeuf-Bosmoreau et Ahun-Lavaveix en Creuse, Argentat en Corrèze…). De manière générale les couches de charbon étaient irrégulières sur le plan géologique et variables en qualité, ce qui rendait leur exploitation malaisée. Malgré tout, les extractions de Bosmoreau et de Lavaveix ont tenu jusqu'après le milieu du XXème siècle (1958 et 1969 respectivement). Mais il ne reste aujourd’hui que le souvenir de cette époque, que vous pouvez découvrir dans le musée de la mine à Bosmoreau-les-Mines.
La météorite de Rochechouart
Le canton de Rochechouart recèle une des plus grandes curiosités géologiques d’Europe. Il y a plus de 200 millions d’années s’est écrasée là une météorite d’au moins 1,5 km de diamètre, percutant la Terre à plus de 70 000 km/h. En quelques secondes, un cratère de 20 à 30 km de diamètre et 1 km de profondeur est creusé. Les roches du socle et la météorite se volatilisent, entrent en fusion, sont projetés dans l’espace, se fracturent, donnant naissance à des roches particulières : les brèches d’impact (les impactites, utilisées dans le bâti local). Le cratère est aujourd’hui usé par l’érosion, il ne reste de la collision que le fond du cratère. Outre les impactites, on voit affleurer des filons d’or, de quartz, de serpentine. Le site fut pendant longtemps une véritable énigme pour les scientifiques et la reconnaissance de l’impact ne date que de 1974. Cette vaste plaine est survolée par bon nombre de papillons : paon du jour, tabac d’Espagne, Robert le diable, sylvain, azuré et autant d’oiseaux : geai des chênes, bondrée apivore, buse variable…
Des parcs naturels régionaux importants
La prise de conscience de l’intérêt et de la fragilité de ces paysages emblématiques a conduit à mettre en place une organisation pour les protéger, notamment avec la création de deux parcs naturels régionaux.
Au cœur de la région, le parc naturel régional de Millevaches, poumon vert de plus de 3 400 km², est une merveille sauvage. Il recouvre le plateau de Millevaches qui représente la quasi-totalité de la montagne limousine avec une altitude variant entre 700 et 900 m, dont font partie le Mont Gargan (731 m d’altitude) et le mont Bessou, en Corrèze, et son jumeau le Puy Pendu, non loin de Meymac, culminant à 977 mètres. Cet espace naturel de 124 communes se situe à cheval sur les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze. Forêts, tourbières, landes, lacs, étangs, rivières, villages paisibles, petits chemins bucoliques… Tout y est ! Plusieurs rivières majeures, dont la Vienne, la Creuse, la Vézère et la Corrèze y prennent leur source avant de partir alimenter le cours de la Loire ou celui de la Garonne. À Millevaches, on compte 12 habitants/km²… Des moments de tranquillité et de plénitude en perspective !
À l’ouest du Massif central et gagnant au sud de la douceur de l’Aquitaine, le parc naturel régional Périgord-Limousin couvre un territoire de 1 800 km² à cheval sur deux départements : la Dordogne et la Haute-Vienne. Les forêts de châtaigniers, les rivières aux eaux vives, les bocages limousins, les vallées périgourdines, ainsi que les plateaux calcaires où les orchidées fleurissent au printemps, composent un paysage d’une grande diversité. Ce cadre naturel abrite une faune et une flore exceptionnelles, avec notamment 110 espèces d'oiseaux nicheurs et des espèces rares et protégées, comme le Sonneur à ventre jaune, la Fritillaire pintade ou le vison d’Europe. En termes de balades, le parc dispose de plus de 2 000 km de sentiers de petite randonnée, tous bien balisés. Il est aussi traversé par plusieurs GR, ainsi que par les itinéraires menant à Saint-Jacques-de-Compostelle.