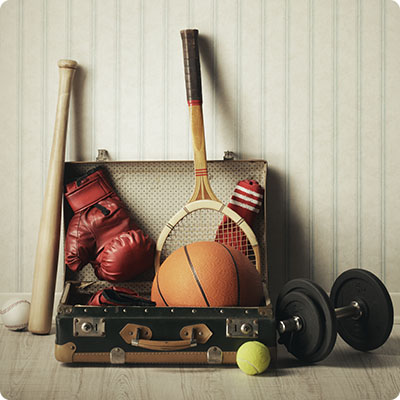Le bâti rural du Limousin : une architecture préservée de grande qualité
Matériau noble et omniprésent, le granite a contribué à développer un savoir-faire remarquable en matière de construction, qui s’observe partout dans la région, du plus prestigieux château à la plus humble annexe de ferme. La qualité architecturale qui en résulte est enracinée dans une culture, celle des métiers du bâtiment. Pendant des siècles (du XVIIIe au XXe siècle), les Limousins ont vendu leur talent saisonnièrement aux régions voisines, et à Paris en particulier : ce sont les maçons de la Creuse, tailleurs de pierre, paveurs, les tuiliers (d’Aubusson, de Felletin, de la Courtine, de Crocq), les scieurs de long, etc. Cette tradition se poursuit aujourd’hui : depuis le début du XXe siècle, le Lycée des Métiers du Bâtiment est installé à Felletin. Lieu emblématique et reconnu, il propose six filières de formation : les métiers du bois, la construction métallique, le gros œuvre, les métiers de l’aménagement et de la finition, la taille de pierre et l’innovation numérique dans le bâtiment.
Le savoir-faire des maçons du Limousin est tel qu’il a donné son nom à une technique : les « limousineries ». Limousiner un mur, c’est le bâtir avec des moellons hourdés au mortier : ces pierres ne dépassent pas 30 cm de hauteur d’assise et sont maniables par un seul homme.
Le patrimoine bâti rural et traditionnel du Limousin est le fruit d’un long processus d’évolution répondant aux besoins de l’occupant. Il correspond à une architecture dite vernaculaire ; sans maître d’œuvre ni architecte, utilisant les ressources et savoir-faire locaux. Observez les fermes et les hameaux. Dans le Limousin, le groupement par village constitue la forme élémentaire et fondamentale de l’association rurale, la cellule sociale de base. Aux XVIIIe et XIXe siècles, époque de laquelle date la quasi-totalité du patrimoine rural bâti, les habitants sont pour l’essentiel des laboureurs, petits propriétaires ou métayers, voire simples journaliers ; des paysans qui pratiquent la polyculture dans un but d’autoconsommation. La grande majorité des fermes et maisons rurales datent du XIXe siècle. Un temps fort de construction marque les années 1825-1850, alors qu'à partir de 1850 se ressentent les effets d’une baisse démographique due à l’exode rural qui marque la fin du siècle. On trouve aussi de nombreuses granges-étables : les deux fonctions de stockage pour le fourrage et la paille et d’abri pour les bêtes sont réunies sous le même toit.
La beauté du granite a donné naissance à des villages particulièrement époustouflants : découvrez Masgot, perché sur une colline, village sculpté insolite et typiquement creusois, ou encore le magnifique village abandonné de Clédat, en Corrèze.
Au cours de vos pérégrinations, soyez attentifs au petit patrimoine bâti du Limousin. Ces constructions d’apparence modeste constituent des témoignages importants des activités économique, sociale ou culturelle des générations passées : fours à pain, moulins, puits, fontaines, ponts, passerelles, lavoirs, chapelles, croix, murs de pierres sèches… Ces édifices font partie intégrante du paysage rural. Les porcheries, séchoirs à châtaigne, poulaillers, pigeonniers, sont également des éléments de petit patrimoine rural présents sur le territoire et ayant une valeur patrimoniale.
Prêtez attention également aux croix monumentales : par leur densité, la grande diversité de leurs formes et parfois leur qualité de sculpture, malgré un matériau rebelle, elles constituent une spécificité forte du territoire. Croix de cimetière, croix de carrefour ou de chemin, croix de mission, plus de 300 croix ont été recensées sur le territoire.
Découvrez également l’architecture et le patrimoine lié à l’eau, du simple usage agricole ou domestique aux pratiques religieuses liées au culte des fontaines. Les moulins à eau, liés à de petites exploitations, sont au XIXe siècle des bâtiments de petite dimension isolés au bord d’un ruisseau ou d’un étang, reliés au village par un étroit sentier. Ils sont pour la plupart alimentés par un bief ou par un canal de dérivation et un réservoir qui donnent une meilleure régulation du débit. La grande majorité de ces moulins sont des moulins à grain, essentiellement à seigle ; plus rarement pour fouler le chanvre ou broyer des faines (fruits du hêtre).
Les ponts et les « planches » (agencement rustique de pierres dressées dans l’eau pour faire office de piles, surmontées, hors de l’eau, par des dalles servant de tablier) font aussi partie du paysage. Construction de granite très simplifiée, le pont comporte une seule ou deux arches ; le tablier est étroit et sans parapet. Il s’agit souvent de constructions ou reconstructions des XVIIe et XVIIIe siècles. Ne manquez pas le Pont de Senoueix, construit au XVIIe, site emblématique du Plateau de Millevaches.
Des abbayes aux châteaux, l’empreinte médiévale
Le Limousin conserve de nombreux témoignages bâtis de l'âge roman. De ses monuments religieux à ses châteaux, ce sont de véritables trésors à découvrir. Le Limousin est au Moyen Âge au cœur des influences du nord et du sud, et manifeste ses propres inventions artistiques. Le patrimoine religieux est vaste : abbayes, églises, chapelles, chartreuses… L'utilisation du granite, du calcaire, du grès, de la roche de brèche (issue de météorite), du marbre ou de la serpentine, ont nourri le savoir-faire des sculpteurs. Les abbayes reflètent, dans leur architecture, leur décor sculpté, leurs peintures, la variété des créations des foyers de bâtisseurs.
On a employé pour les édifices les plus importants le matériau le plus commun en Limousin : le granite, plus sombre et plus difficile à travailler que le calcaire. Avec la Bretagne, le Limousin est l'une des rares régions françaises où les sculpteurs romans ont dû affronter le granite. Nous avons là un véritable marqueur d'identité. Cet art tributaire du granite, dominé par la recherche de l'effet plastique, survit jusque vers 1150 et même au-delà sur les chapiteaux de Saint-Léonard et de Solignac, mais n'est pas sorti de la région. C'est en ce sens qu'on peut le qualifier de sculpture romane limousine. Elle remplit deux fonctions principales : d’une part, elle souligne fortement les articulations essentielles du bâtiment, l'effet étant encore accentué par le contraste polychromique introduit par l'emploi fréquent de pierres différentes de celles du gros œuvre (grès, calcaire, serpentine). D'autre part, elle est chargée d'un rôle symbolique en concentrant l'attention sur les baies, sources de lumière, et surtout sur les portails, accès à la maison divine.
Ne manquez pas de visiter l’abbaye de Beaulieu-sur-Dordogne au portail exceptionnel, l’abbaye cistercienne d’Aubazine et le magnifique Canal des moines, l’abbatiale des XIe et XIIe siècles de Bénévent-l’Abbaye, l’abbatiale Sainte-Valérie de Chambon-sur-Voueize, la collégiale d’Eymoutiers… De véritables joyaux de l’art roman.
Vous découvrirez également de magnifiques châteaux forts et de grandes maisons de maître aux allures de demeures “aristocratiques”. La période allant du XIVe au XVIIe siècle constitue un véritable âge d'or du château-fort, témoin du sentiment d'insécurité : le paysage monumental que l'on connaît aujourd'hui s'est mis en place, pour l'essentiel, à partir de la guerre de Cent ans et les éléments défensifs ont perduré au-delà des guerres de Religion.
La Route Richard Cœur de Lion est un circuit touristique historique qui vous invite à la découverte de châteaux, églises médiévales, abbatiales, tout en découvrant la campagne limousine. Maître au XIIème siècle de notre territoire, Richard Cœur de Lion guerroya contre bon nombre de vassaux avant de trouver la mort au pied du château de Châlus Chabrol. À Cussac, Dournazac et aux alentours, cet itinéraire serpente entre le Massif des Feuillardiers au nord et le Pays Arédien au sud de la Haute-Vienne. Il vous permettra de découvrir le Château de Brie, le Château de Lavauguyon, le Château de Cromières, le Château de Montbrun, le Château des Cars, le Château de Rochechouart, et bien d’autres.
Les petites cités de caractère et les plus beaux villages de France
Impossible de parler de l’architecture du Limousin sans parler de ses sites patrimoniaux remarquables : petites cités de caractère et plus beaux villages de France vous attendent.
En Haute-Vienne, ne manquez pas Eymoutiers, aux portes de Vassivière. La collégiale combine architectures romane et gothique et est remarquable pour son ensemble de vitraux anciens, le plus important du centre de la France : 16 verrières du XVe siècle, situées dans son chœur gothique. L’ancien couvent des Ursulines, construit au XVIIe siècle pour accueillir des religieuses qui fuyaient la peste de Limoges, est aussi d’une grande valeur patrimoniale. Le Dorat, dans le nord du département, vaut également le détour pour découvrir la collégiale Saint-Pierre, classée au titre des monuments historiques depuis 1846, la Porte Bergère, l’unique porte fortifiée qui reste en Haute-Vienne, ainsi que les vestiges des remparts.
En Creuse, Bénévent-l’Abbaye, située sur une route de St Jacques de Compostelle, vous invite à découvrir le Scénovision, un parcours-spectacle original pour remonter le temps, et surtout sa très belle abbatiale et ses jardins, construite aux XIème et XIIème siècles. L’architecture de cette église très homogène est typique de l’art roman limousin. Son clocher porche massif, son portail d’entrée polylobé et sa lanterne octogonale sur la croisée du transept font de cet édifice un monument d’exception. À une vingtaine de kilomètres de là, ne manquez pas Bourganeuf, ville créée au XIIème siècle par l’ordre religieux et militaire des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Dominée par l’emblématique tour Zizim, cette belle cité médiévale creusoise abrite un beau patrimoine à découvrir.
En Corrèze, ne manquez pas la petite ville de Treignac, au patrimoine architectural et naturel remarquable : Vieux Pont du XIIIème siècle, églises et chapelles, fontaines, halle aux grains, tour panoramique du XVème siècle et maisons à colombages.
Quant aux plus beaux villages de France, ils seront nombreux à vous éblouir ! Mortemart en Haute-Vienne, Collonges-la-Rouge, Turenne, Curemonte, Beaulieu-sur-Dordogne, Ségur-le-Château, Saint-Robert en Corrèze… Un patrimoine fascinant vous attend.
Limoges, une ville « Art déco »
L'architecture Art déco a laissé une grande empreinte à Limoges. L'héritage de cette époque est encore bien visible aujourd'hui dans la capitale limousine, il suffit de lever la tête : lignes géométriques résolument modernes, motifs stylisés, corbeilles, fleurs, céramiques, voire vitraux apparents… L’Art déco est partout !
Né juste avant la Première Guerre mondiale, le style prend son envol au début des années 20. Son point d’orgue est sans doute l’Exposition Universelle de 1925 à Paris, où près de 21 pays le célèbrent, et où le Limousin, alors 7ᵉ région économique française, y possède son pavillon, qui met à l’honneur tapisseries d’Aubusson, émaux et porcelaines inspirées par cette modernité. Le fronton du pavillon limousin portait d’ailleurs cette inscription : « Limoges, ville porcelainière du monde ».
Les architectes se sont emparés de ce style pour reconstruire sur une période d’après-guerre. C’est ainsi, par exemple, que naît en 1919 le pavillon du Verdurier, avec ses céramiques, ses auvents et ses guirlandes de fleurs. Cinq ans plus tard, le même architecte, Roger Gonthier, dote de nombreux éléments Art déco l’emblématique gare des Bénédictins, notamment ses vitraux, une composition tout en équilibre de rameaux de chênes et de châtaigniers. La maison du Peuple, rue Charles Michels, se voit elle aussi dotée de vitraux, signés Francis Chigot et Pierre Parot, parmi les grands noms du style. Un magnifique patrimoine à découvrir.