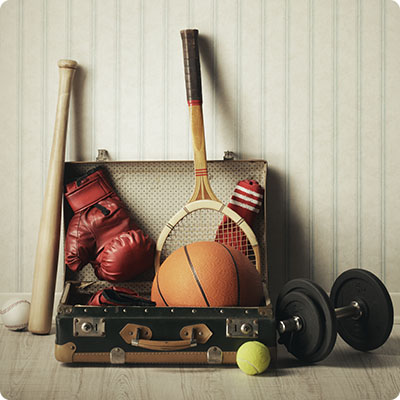Aux origines
Les premières grandes cultures préhistoriques sédentaires se distinguaient par des habitations en terre puis en clayonnage (armature en bois et torchis). De plan rectangulaire, ces maisons posées sur de petites fondations possédaient des sols carrelés, le plus souvent en argile. Les toits, généralement à deux pans, étaient couverts de chaume. Les villages de Tarintsi, Anzabegovo, ou bien encore Tumba Madzari possèdent encore des vestiges de cette première architecture. Les rives du lac d’Ohrid abritent, elles, des traces d’habitat palafittique, c’est-à-dire des maisons construites sur pilotis afin de s’adapter à l’environnement lacustre. À l’âge du bronze, les maisons sont désormais construites en pierre et dans des lieux difficiles d’accès. Une architecture mégalithique qui se poursuit à l’âge du fer, comme le montrent les tombeaux en pierre ou céramique peinte de la nécropole de Demir Kapiya ou les tombes princières de Trebenichta. Mais le site mégalithique le plus impressionnant du pays reste le Rocher de Kokino. Ses éléments en pierre sont répartis sur deux plateformes séparées par 19 m de hauteur. Voyez la plateforme inférieure flanquée de quatre trônes de pierre que les rayons du soleil viennent éclairer ! Le pays va connaître un nouvel essor durant l’Antiquité, d’abord sous l’influence de la Grèce. C’est la naissance des premières villes fortifiées entourées de remparts, le plus souvent en pierre sèche. Entre scénographie et fonctionnalité, cette urbanisation théâtrale a pour point central l’agora. Le style dominant est l’ordre dorique, que l’on reconnaît à l’impression de force et de simplicité qu’il dégage et à ses colonnes massives et trapues. Le site de Bylazora en est le parfait exemple. Traversés par la Via Egnatia, grande voie de communication construite par les Romains, de grands centres urbains font leur apparition. Heraclea Lyncestis (Bitola) est l’un de ceux-là. Le site conserve d’impressionnants portiques (galeries à colonnes en façade des édifices), thermes, théâtres, structures défensives et votives. Scupi (Skopje), seule cité à avoir été entièrement fondée par les Romains, possède des vestiges qui illustrent ce mélange de monumentalisme et de pragmatisme qui caractérise l’architecture romaine : voyez son aqueduc aux cinquante-cinq arches de pierre, son théâtre, ses thermes et basiliques civiles. Stobi, elle, conserve de belles traces de cet urbanisme toujours très théâtral avec ses édifices répartis en trois terrasses surplombant la rivière, ses enceintes rythmées de portes monumentales et ses belles demeures décorées de mosaïques.
Splendeurs médiévales
Entourées de murs cyclopéens (faits d’énormes blocs irréguliers), protégées de tours de plan circulaire ou carré, les forteresses de pierre macédoniennes se divisent en une haute cour avec le donjon (demeure seigneuriale) et une basse cour (sorte de petite ville abritant artisans et commerçants). Parmi les grands vestiges de cette architecture défensive, notons les tours de Kratovo, la forteresse d’Isar, dont les murs d’enceinte dépassaient 1,3 m de large, la forteresse de Samuel avec ses dix-huit tours carrées, ses quatre portes monumentales et ses murs pouvant atteindre 16 m de haut, ou bien encore l’étonnante forteresse de Skopje avec ses tours et ses vestiges d’édifices cultuels, militaires et commerciaux.
Le Moyen Âge est également une période d’effervescence religieuse et marque le triomphe de l’architecture byzantine. Cette dernière se caractérise par des appareillages toujours très soignés en pierre et brique (la brique permettant plus de légèreté et de flexibilité et donc la création de voûtes et coupoles), un grand équilibre des volumes, et une grande recherche décorative intérieure. Les pavements des sols, en brique ou marbre, révèlent d’étonnantes techniques comme celle de l’opus sectile, réalisée avec des plaquettes de marbre ou de pierres de couleur, parfois de verre coloré, découpées et assemblées de façon à constituer un motif figuratif. Mais le grand élément du décor byzantin est la fresque, réalisée à partir de poudres minérales ou végétales ajoutées à la chaux, la peinture étant ensuite appliquée sur du mortier frais avant séchage. Couleurs éclatantes, grande expressivité et richesse des motifs caractérisent ces fresques. Originellement simple et de plan carré, précédée d’un narthex (sorte de portique ou vestibule) et surmontée d’une ou deux coupoles, les églises byzantines vont progressivement opter pour des plans en croix plus élaborés, notamment le plan dit en croix inscrite offrant de fascinants jeux de volumes et de géométrie, et où ressortent particulièrement les iconostases (superbes panneaux de bois sculpté séparant le sanctuaire, réservé aux prêtres, du naos, la salle centrale réservée aux pénitents). Coupoles multiples et sublimes effets de polychromie entre la pierre et la brique complètent ces évolutions. Surnommée « la Jérusalem des Balkans », Ohrid possède les plus beaux et plus anciens chefs-d’œuvre de cette architecture byzantine, à commencer par l’église Saint-Jean de Kaneo. Autre chef-d’œuvre : l’église Saint-Georges de Kurbinovo qui a récemment entamé une grande phase de restauration. Les monastères de Lesnovo, Treskavets, Polog ou bien encore Sveti Naum, dont la silhouette rappelle celle des forteresses et dont les différents bâtiments sont organisés autour de grandes cours, sont également des immanquables.
Richesses ottomanes
L’élément central de la ville ottomane est le bazar, carsija, que l’on reconnaît à son lacis d’étroites ruelles pavées bordées de maisons basses abritant des échoppes. Au sein du bazar se trouve le bezisten, ou marché couvert, de plan rectangulaire, recouvert de voûtes et coupoles, et auquel on accède par des portes monumentales. Mais le bazar n’est pas qu’un lieu commercial, il abrite également tous les édifices phares de la cité, à commencer par les mosquées. Ces dernières sont généralement de plan carré, surplombées d’un dôme, et flanquées d’un élégant minaret élancé. D’une grande sobriété extérieure, les mosquées révèlent un très riche décor intérieur fait d’éléments peints ou sculptés en faïence, marbre ou bois, suivant notamment le motif du muqarnas ou stalactite, et de superbes inscriptions calligraphiques. La grande cour centrale ouverte autour de laquelle s’organisent les mosquées abrite souvent un ou plusieurs turbe ou mausolées aux formes géométriques élaborées, eux-aussi surplombés de coupoles et parfois décorés de superbes faïences ornementales. Les mosquées étaient elles-mêmes souvent intégrées dans des complexes plus vastes comprenant des médersas ou écoles coraniques, des imarets ou cuisines populaires, et des caravansérails, vastes auberges-entrepôts organisées autour d’une cour fermée entourée d’une galerie à deux étages. À cela s’ajoute également une riche architecture de l’eau comme le montrent les hammams. Ces derniers se composent généralement de deux structures identiques, l’une réservée aux hommes et l’autre aux femmes. Les grandes salles d’eau y sont surplombées de coupoles et décorées d’élégants motifs géométriques ou floraux. Les Ottomans ont également érigé de nombreuses tours d’horloge, qui se distinguent souvent par des socles carrés en pierre, un fût octogonal et un sommet à terrasse en brique, ainsi que de superbes maisons que l’on reconnaît à leurs fondations de pierre et leurs étages en bois à encorbellement. Le légendaire Vieux-Bazar de Skopje, dans le quartier de Stara Čaršija, abrite parmi les plus beaux trésors de l’architecture ottomane, à l’image des mosquées Mustafa-Pacha, Sultan Murat et Aladja, du hammam Daout Pacha et du caravansérail Suli. Le Bazar de Bitola est un autre immanquable avec sa mosquée Yeni et son hammam Deboy. Bien sûr, ne manquez pas l’unique et fascinante mosquée colorée de Tetovo. À la fin du XIXe et au tournant du XXe siècle, l’Empire ottoman commence à s’affaiblir. Une situation qui se traduit par un regain de l’architecture chrétienne et par l’ouverture aux influences occidentales. Porté par les maîtres Mijacki, venus des villages de montagne et organisés en groupe maîtrisant tous les domaines de la construction, notamment la sculpture sur bois, ce renouveau se traduit par des édifices reprenant les codes byzantins mais poussant encore plus loin les recherches décoratives, comme le montre le monastère Saint-Jean-Bigorsky. L’un des grands représentants de ce « renouveau national » est Andrea Damjanov, à qui l’on doit notamment l’église de la Nativité-de-la-Vierge à Skopje ou l’église de l’Assomption à Novo-Selo. Un éclectisme que l’on retrouve à Skopje dans des édifices comme le palais Ristíc mêlant néobaroque, néobyzantin et même Art Nouveau, ou bien encore à Bitola, surnommée « la ville des consuls » et qui regorge de palais et demeures aux façades décorées de stucs et peintes aux couleurs pastel.
Triomphe du modernisme
Dans la nuit du 25 au 26 juillet 1963, un terrible séisme secoue le pays. Skopje est la plus durement touchée avec 80 % de ses bâtiments à terre. Alors que le monde s’enlise dans la guerre froide, l’ONU va mettre en place un vaste programme de solidarité internationale, faisant appel aux meilleurs experts de l’Est et de l’Ouest pour faire de Skopje un symbole d’espoir. On confie tout d’abord au Polonais Adolf Ciborowski, qui avait déjà œuvré à la reconstruction de Varsovie, le soin de repenser la ville. Il en change l’orientation et suit les contours du Vardar, dont les berges sont laissées à la nature ou transformées en espace vert (une manière d’éviter de construire en pleine zone inondable), tandis que de nouveaux grands axes routiers sont construits pour permettre la croissance future de la ville. Sont également créés de vastes boulevards, le long desquels sont construits de grands immeubles d’habitation collectifs séparés par des espaces verts, ainsi que des grands centres commerciaux. L’important est de pouvoir rapidement reloger la population et relancer l’économie. Le centre-ville, lui, va être entièrement repensé par le célèbre architecte japonais Kenzo Tange, dont l’approche globale est fondée sur les fonctions et les besoins. Il pense la ville comme une série de pôles aux fonctions variées – administratives, commerciales, culturelles, résidentielles –, le tout organisé autour de places publiques. Le centre-ville est entouré du Gradski Zid ou « Mur de la Ville », sorte de ceinture de grands blocs d’immeubles. Pour autant, un profond respect pour le bâti historique a poussé les architectes à maintenir des constructions basses autour du Vieux-Bazar et à limiter la hauteur des constructions autour de la forteresse afin de ne pas gâcher les perspectives. Le style privilégié pour cette reconstruction est le brutalisme. Ce terme désigne une architecture sans revêtement, fondée sur l’utilisation logique des matériaux qui annonce directement la fonction de la construction. Le projet de Kenzo Tange n’a pas été réalisé dans sa totalité, mais ses créations n’en sont pas moins devenues des symboles de la ville, à l’image de sa place Macédoine et son grand centre commercial, son Grand Opéra, et surtout son « Pont-Gare », édifice monumental qui a nécessité pas moins de 70 000 m3 de béton et 11 000 t de fer. Skopje est jalonné de symboles de ce renouveau moderniste : le bâtiment des télécommunications aux allures de robot avec ses fenêtres en hublot, l’université Saints-Cyrille-et-Méthode avec ses volumes triangulaires et rectangulaires s’imbriquant dans une symphonie de béton, ou bien encore la désormais célèbre résidence universitaire Goce Delcev. Symbole des élans progressistes et socialistes portés par la Yougoslavie de Tito, cette architecture de béton se révèle aussi dans de grands mémoriaux, à l’image du Makedonium de Krusevo, étonnante « cellule virale » de béton surplombant une nécropole de colonnes. Qualifiée par certains de grise et sans âme, cette architecture moderniste de béton est, pour beaucoup, indissociable d’un passé parfois idéalisé et qui porte désormais le nom de « yougostalgie ».
Quête identitaire
Dans les années 2000, la droite ultraconservatrice alors au pouvoir lance le programme Skopje2014. Objectif : afficher les racines antiques de la Macédoine du Nord, revendiquer l’héritage d’Alexandre le Grand comme fondement de l’identité nationale, et donc masquer le passé yougoslave. Très vite, le projet s’attire de nombreuses critiques, notamment en raison de sa relecture erronée de l’histoire et de son coût exorbitant. De nombreux architectes sont également contraints de porter plainte pour violation de droits d’auteur, leurs réalisations modernistes ayant été dénaturées sans leur autorisation. Mais qu’importent les critiques, la machine est en marche et entre 2010 et 2016, cent trente monuments et statues, véritables mastodontes néoclassiques, vont être érigés ou rénovés sur un périmètre d’à peine 2 km2, dont le Musée archéologique, le Théâtre national Macédonien, le palais de l’Assemblée et surtout la porte de Macédoine, arc de triomphe de 21 m de haut sculpté de bas-reliefs exaltant les héros (supposés !) de la nation. Colonnades, dorures, frontons décorés, corniches ployant sous le poids des sculptures… cette architecture très kitsch sera la première cible de la « révolution des couleurs » de 2016. Rejetant l’ultraconservatisme, les jeunes Macédoniens éclaboussent les murs de la capitale de couleurs éclatantes, comme pour mieux en souligner l’aberration historique et sociale. L’architecture contemporaine en Macédoine du Nord est tributaire de ces luttes et les innovations sont encore rares, même si l’on peut noter la transformation de la place Skanderbeg à Skopje qui mêle avec élégance art, architecture et aménagement paysager. La véritable identité de la Macédoine du Nord est en réalité à découvrir dans ses pittoresques villages. Les élégantes maisons d’Ohrid, les kuki de Krouchevo ou bien encore les maisons-forteresses de Galitchnik possèdent toutes des caractéristiques communes. Leurs fondations sont en maçonnerie de pierre renforcée par des madriers afin d’assurer une meilleure résistance au séisme. Les étages, eux, sont composés d’une ossature en bois que l’on complète avec des lattes de bois ou des gravats de brique ou pierre que l’on recouvre ensuite d’un enduit de chaux. L’ensemble est percé de nombreuses fenêtres étroites et réparties de façon symétrique. Le rez-de-chaussée est réservé au stockage des denrées et du bétail, tandis que les étages sont destinés au logement. Ils s’organisent autour d’un escalier central et de l’espace phare de la maison : le cardak, grande pièce commune faisant office de salle de séjour et de réception. De forme souvent cubique, ces maisons sont surplombées de toits en croupe couverts de tuiles ou d’ardoise. Alors que les grandes villes du pays souffrent d’une pollution extrême, ces villages offrent un véritable havre de paix et de pureté et se font désormais les ambassadeurs d’un écotourisme respectueux de l’identité unique et sauvage de la Macédoine du Nord.